« Tous ces points peuvent être facilités par un choix judicieux d’implantation : il s’agit d’opter pour un régime coopérant mais peu regardant sur le droit du travail, si possible autoritaire et doté d’infrastructures stables, où la culture patriarcale et la réserve de main-d’œuvre font loi. Sur place, il faut veiller à limiter les discussions entre ouvriers, à dualiser les troupes, à prévenir les revendications syndicales, voire à organiser toute une vie autour de l’usine, de manière à disposer des uns et des autres à satiété. »
Sous la forme d’un faux manuel adressé aux dirigeants d’entreprises, ce Manuel de management décomplexé (La Découverte/Zones) effeuille avec précision les rouages du capitalisme mondialisé. Derrière l’ironie d’une telle démarche, on trouve une enquête documentée qui révèle comment produire l’obéissance, organiser la fragmentation des travailleurs et, lorsque tout échoue, écraser la rébellion.
Anthony Galluzzo choisit la seconde personne du pluriel, apostrophe le patron, parle le même langage que le donneur d’ordres et déroule, chapitre après chapitre, les méthodes d’un pouvoir industriel ne tendant que vers un profit maximisé. Sous couvert de conseils stratégiques, l’auteur expose patiemment la grammaire actuelle de la domination au travail. Le projet ne souffre aucune ambiguïté. Il s’agit de décomposer le management. Non pas l’art anodin d’organiser des équipes, mais plutôt l’ensemble des dispositifs qui rendent possible l’extraction de valeur à l’échelle mondiale. On avance alors par mécanismes précis, exemples situés, avec des références sociologiques utiles. On croise Michael Burawoy et Stuart Hall, on plonge au cœur d’enquêtes de terrain en Asie ou dans les Caraïbes, on se penche sur des statistiques de l’inspection du travail, des scandales médiatiques ou encore des procès retentissants. Et le tout forme un ensemble glaçant, prêt à l’emploi.
La production de la vulnérabilité
Au fondement du système, il y a l’élargissement soudain du réservoir mondial de main-d’œuvre, à la fin du XXe siècle. L’intégration de la Chine, de l’Inde et de l’ex-bloc soviétique au marché mondial a doublé, en quelques années, la force de travail disponible. Cette mutation a présidé au déplacement du rapport de force en faveur du capital. La mobilité des capitaux contraste en effet avec l’immobilité relative des travailleurs. Les firmes arbitrent, délocalisent quand elles le souhaitent, fragmentent au besoin les chaînes de production. La menace de la concurrence internationale aide à instaurer un ordre disciplinaire permanent.
Ce, d’autant plus que la financiarisation accentue encore la pression. L’entreprise n’est plus seulement tenue à l’équilibre comptable : elle doit créer de la valeur pour ses actionnaires. Les coûts tiennent lieu de variables d’ajustement, les délais se raccourcissent, les marges des sous-traitants s’érodent. Au sommet : la marque, la conception, le marketing ; à la base, une cascade de fournisseurs pris à la gorge. La sous-traitance se mue alors en un principe d’organisation. Elle permet d’externaliser la production, mais aussi les risques, les accidents… et les illégalités.
Diviser pour mieux régner
Anthony Galluzzo insiste sur un point essentiel, et largement impensé : la domination se nourrit de divisions préexistantes qu’elle active et réorganise. Il en va notamment ainsi pour la division sexuée du travail. Les femmes se voient concentrées dans les tâches répétitives, précaires et mal rémunérées, pendant que les postes d’encadrement demeurent majoritairement masculins. À cette hiérarchie s’ajoutent des pratiques de harcèlement et de favoritisme qui fragmentent les collectifs et installent une concurrence sur le terrain. La domination patriarcale est un auxiliaire de la discipline productive.
La division raciale ensuite, comprise au sens large. Héritée des structures coloniales ou produite par des segmentations ethniques, religieuses ou régionales (voire les trois à la fois, comme avec les Ouïghours en Chine), elle assigne des groupes à des positions déterminées dans la hiérarchie du travail. L’exemple de Trinité-et-Tobago, les politiques migratoires américaines de la fin du XIXe siècle ou encore les rivalités entre travailleurs en Malaisie ou aux États-Unis : partout, la mise en concurrence des groupes exacerbe le ressentiment et entrave la solidarité.
Tous ces points peuvent être facilités par un choix judicieux d’implantation : il s’agit d’opter pour un régime coopérant mais peu regardant sur le droit du travail, si possible autoritaire et doté d’infrastructures stables, où la culture patriarcale et la réserve de main-d’œuvre font loi. Sur place, il faut veiller à limiter les discussions entre ouvriers, à dualiser les troupes, à prévenir les revendications syndicales, voire à organiser toute une vie autour de l’usine, de manière à disposer des uns et des autres à satiété.
Consentir plutôt que contraindre
Le contrôle ne saurait toutefois reposer sur la seule peur. Une large part de l’ouvrage explore la « fabrication du consentement ». Il s’agit de gouverner « de la main gauche » : transformer l’ordre imposé en ordre intériorisé.
Le travail en équipe, la rhétorique familialiste, la proximité affichée des managers, les dispositifs participatifs produisent une autonomie sans pouvoir. Les objectifs restent fixés en amont, mais les salariés sont invités à se les approprier. Les micro-concessions, les attentions personnelles, la culture d’entreprise finissent par former un ciment purement symbolique. L’ouvrier, exécutant de fait, se pense « citoyen industriel » par apparence, intégré à une communauté aussi fictive qu’un village Potemkine.
Les instances de médiation internes – comités divers, procédures prud’hommales d’entreprise – contribuent facticement à cette intégration. Elles fragmentent la contestation et doublent le syndicat d’une voie d’expression parallèle, plus contrôlable. Ménager une parenthèse de quinze minutes pour expédier quelques problèmes mineurs constituera pour le dirigeant avisé une soupape salutaire, à bien des égards.
La responsabilité sociale, un voile corporate
Il est aussi question, plus loin, de la responsabilité sociale des entreprises. À la suite des scandales des années 1990 – travail des enfants, conditions indignes chez certains sous-traitants –, les grandes marques ont élaboré des codes de conduite, multiplié les audits, investi des initiatives multipartites. Le discours moral s’est institutionnalisé.
L’auteur en montre l’extrême ambivalence. Ces dispositifs protègent la réputation des marques, éloignent la menace d’une régulation étatique, mettent en scène l’autorégulation. Les audits, souvent confiés à des cabinets privés, donnent une apparence d’objectivité. Les initiatives multipartites affichent une gouvernance inclusive, tout en étant largement financées par les entreprises qu’elles sont censées contrôler.
Pendant ce temps, la pression économique demeure : délais raccourcis, prix compressés, pénalités, changements de dernière minute. Le sous-traitant, pris entre les exigences commerciales et les codes éthiques, rogne sur les conditions de travail. Le scandale, lorsqu’il éclate, est routinisé : expression d’émotion, déni plausible, annonce de nouvelles enquêtes, promesse de réformes. L’incident est présenté comme une anomalie, jamais comme le symptôme d’un système aveugle à ses propres défaillances.
La philanthropie parachève le dispositif. En finançant des programmes éducatifs ou sanitaires dans les pays producteurs, l’entreprise déplace sciemment le problème : ce n’est plus l’exploitation qui est en cause, mais le déficit de développement local. Et l’entreprise y apporte une solution clé en main.
Écraser la rébellion
Lorsque, malgré tout, un syndicat émerge, le ton change. D’abord, il faut contenir juridiquement : obstacles bureaucratiques à la création d’organisations représentatives des travailleurs, référendums contraignants, délais procéduraux, limitation du droit de grève. L’État apparaît ici comme un partenaire décisif, par inaction ou par restriction active.
Ensuite, on peut professionnaliser l’anti-syndicalisme : cabinets spécialisés, formations des cadres, repérage des meneurs, constitution de dossiers disciplinaires. La guerre est psychologique. Mutations punitives, placardisation, affectation aux tâches les plus pénibles : l’objectif consiste à épuiser l’adversaire.
Dans certains contextes, la violence devient même physique. Le livre évoque des cas latino-américains où des syndicalistes ont été menacés, enlevés, assassinés, parfois dans un environnement de connivence trouble entre entreprises, sociétés locales et groupes paramilitaires. L’affaire Coca-Cola/Sinaltrainal en Colombie révèle beaucoup de ces dérives : restructurations, précarisation, syndicats maison, violences ciblées, procès internationaux…
La grève, enfin, est envisagée comme un moment critique. Elle peut souder un collectif, produire une mémoire apte à nourrir les résistances futures. Mais elle peut aussi être retournée : identifier les leaders, accentuer les divisions entre grévistes et non-grévistes, criminaliser les meneurs, bref mener une énième guerre d’usure. Dans ce cas, l’entrepreneur peut continuer la production, déployer une propagande, laisser le temps et la fatigue éroder le mouvement.
Un manuel pour comprendre
Ce Manuel de management décomplexé consiste en un dispositif d’énonciation : en parlant comme le pouvoir, il le met à nu. Le lecteur, placé du côté du dirigeant fictif, éprouve la cohérence glacée d’un système qui relie logistique mondiale, gestion des ressources humaines, droit du travail, communication et, à l’extrême, coercition armée.
Le management apparaît comme une « technologie » politique globale, articulant fragmentation sociale, production du consentement, externalisation des risques et neutralisation de la contestation. À rebours des discours enchantés sur l’entreprise responsable, Anthony Galluzzo rappelle que la gouvernance privée ne remplace pas la régulation publique : elle procède surtout en la contournant.
Jonathan Fanara
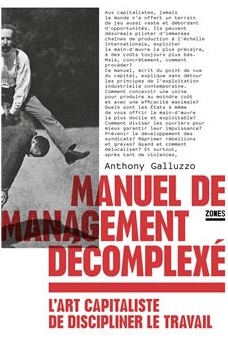
Manuel de management décomplexé, Anthony Galluzzo –
La Découverte/Zones, 12 février 2026, 272 pages

Laisser un commentaire