« La prétendue « complexité » s’apparente en réalité à un dispositif de désarmement moral : trop compliqué pour s’indigner, trop lointain pour juger, trop chargé symboliquement pour être nommé. La souffrance palestinienne est reconnue du bout des lèvres, puis reléguée dans les soutes. Ce n’est pas le mensonge frontal qui domine, mais une forme de pudeur intellectuelle qui conforte la domination. »
Avec La Mauvaise Cause, le journaliste français Denis Sieffert procède par désassemblage méthodique. Son objet d’étude ? L’attitude des élites et des intellectuels face au conflit israélo-palestinien, et plus spécifiquement au sionisme. L’auteur témoigne de ce qui permet à une partie des élites françaises de justifier l’injustifiable tout en se donnant l’illusion de la hauteur morale.
Premier étage : l’allumage moral
Toute fusée commence par un phénomène d’ignition. Ici, il porte un nom : le 7 octobre 2023. L’événement agit comme une mise à feu immédiate, brutale, gorgée d’affects mal assimilés. La sidération est réelle, la violence incontestable, mais très vite, l’émotion se mue en carburant politique. Un mot s’érige en code d’accès : terrorisme. Il faut le prononcer distinctement pour avoir le droit de parler. Ne pas s’y plier, c’est rester sur le pas de tir, disqualifié.
Denis Sieffert observe ce moment avec distance critique. Ce premier étage ne vise pas à comprendre les tenants et aboutissants de l’événement, mais à propulser une rhétorique : il arrache les faits à leur histoire, coupe les amarres coloniales et transforme la complexité en un rituel d’expiation verbale. Le débat public français décolle ainsi sur une morale de l’instant, qui ne supporte ni nuance ni mémoire.
Deuxième étage : la séparation des charges
Une fois l’altitude atteinte, on largue ce qui pèse. Dans La Mauvaise Cause, ce processus se nomme confusion. Judaïsme et sionisme, antisionisme et antisémitisme deviennent interchangeables, comme si l’histoire, la théologie, la politique et l’éthique pouvaient être compressées en un seul bloc émotionnel. Cette confusion n’a rien d’accidentel ; elle constitue un mécanisme de stabilisation en vol.
En effet, elle permet tout à la fois de sanctuariser un État, de moraliser une politique et de porter le soupçon sur toute critique. L’ouvrage montre très bien combien cette opération ancienne s’est perfectionnée au fil du temps. Elle fonctionne comme un bouclier thermique : toute contestation brûle à l’entrée de l’atmosphère médiatique.
Troisième étage : la trajectoire imposée
La fusée est désormais hors de portée du sol. Il faut lui donner une direction. C’est ici qu’intervient la grande narration de substitution : le conflit israélo-palestinien sort du champ du colonialisme, il devient un épisode quelconque d’une guerre globale. Le Hamas est volontiers arrimé à Daech, l’Iran devient une sorte d’architecte caché, l’Occident le rempart assiégé. La Palestine disparaît en tant que sujet politique ; on en fait un décor ou un prétexte.
Denis Sieffert insiste d’ailleurs sur cette manœuvre : en déplaçant la focale, on neutralise la question territoriale, l’occupation, le blocus, l’asymétrie radicale des puissances. La trajectoire est rectiligne, rassurante, presque familière. Elle évite les turbulences du réel. Et c’est plutôt commode.
Quatrième étage : les passagers respectables
Cette fusée embarque des passagers : ils sont experts, éditorialistes, figures morales et donnent à la trajectoire son vernis de légitimité. C’est l’une des parties les plus corrosives du livre. L’auteur questionne les voix installées, celles qui parlent avec assertion, qui invoquent la complexité, qui brandissent la prudence comme un étendard. On y retrouve, en bonne place, Gilles Kepel, BHL, Delphine Horvilleur ou encore Caroline Fourest.
La prétendue « complexité » s’apparente en réalité à un dispositif de désarmement moral : trop compliqué pour s’indigner, trop lointain pour juger, trop chargé symboliquement pour être nommé. La souffrance palestinienne est reconnue du bout des lèvres, puis reléguée dans les soutes. Ce n’est pas le mensonge frontal qui domine, mais une forme de pudeur intellectuelle qui conforte la domination.
Cinquième étage : l’orbite juridique et morale
Arrive alors la zone de friction maximale : le mot génocide. Longtemps tenu à distance, comme s’il risquait de faire exploser l’engin, comme s’il ne pouvait s’appliquer à un peuple jadis décimé, il finit par s’imposer sous le poids des faits, des rapports, des destructions systématiques des conditions de vie. Rappelons quelques chiffres : 17 ans de blocus, 70 % du territoire gazaoui détruit, 60 000 morts (selon la revue The Lancet), avec 83 % de victimes civiles… Ceux qui, tardivement, changent de ton ne le font pas tous par souci des victimes ; certains semblent surtout craindre que la fusée perde son orbite morale, que l’image d’Israël se consume dans l’atmosphère internationale. L’essai observe ces revirements avec une ironie sèche, presque triste.
Dernier étage : les débris et les survivances
Une fusée laisse parfois des débris derrière elle. Mais elle peut aussi libérer autre chose. Alors, on peut citer quelques trajectoires dissidentes, des fragments d’universalisme. La Mauvaise Cause se termine sur ces voix juives françaises (Esther Benbassa, Jean-Christophe Attias, Rony Brauman, etc.) qui refusent l’assignation identitaire, qui rompent avec la logique de forteresse et rappellent une évidence devenue subversive : critiquer un État n’est pas haïr un peuple.
La Mauvaise Cause est un texte de gravité, au sens physique autant que moral. Il montre comment une société fabrique des postulats intellectuels capables de survoler les ruines sans jamais les regarder en face. Et comment, parfois, il suffit de démonter les étages un à un pour que l’ivresse de l’altitude cesse de faire illusion.
Jonathan Fanara
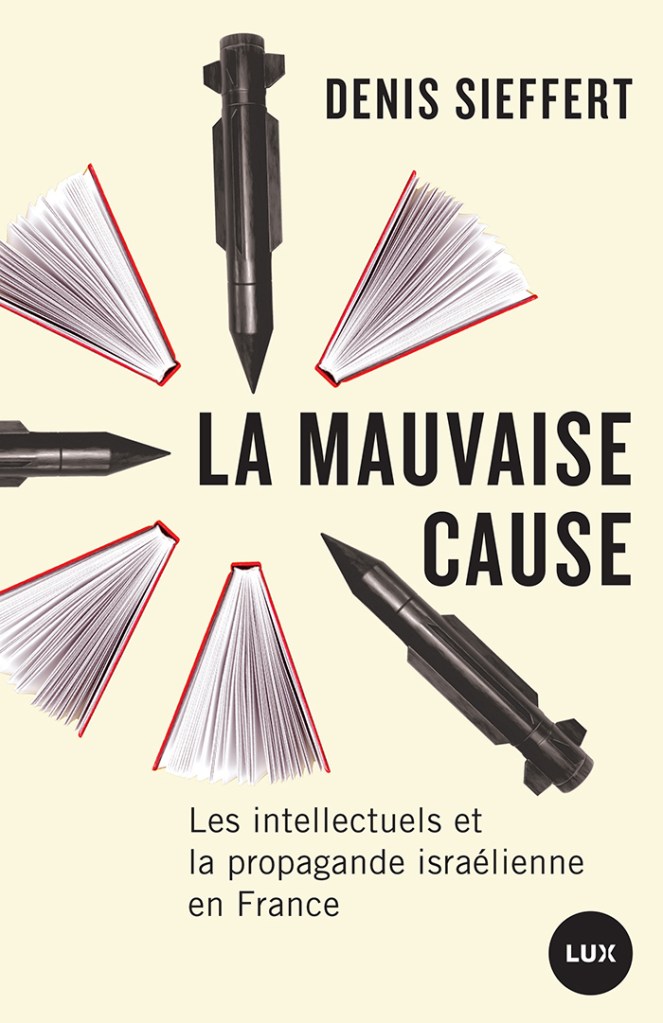
La Mauvaise Cause, Denis Sieffert – Lux, 23 janvier 2026, 192 pages

Laisser un commentaire