
« La nation n’a que des paradoxes à offrir. » Cette phrase, lapidaire, ferait presque office de gifle à l’évidence tranquille du mot. Dans son opuscule paru aux éditions Anamosa, la sociologue Sarah Mazouz n’écrit pas un plaidoyer, ni même un réquisitoire, mais bien une œuvre de dévoilement. Le genre de texte qui entreprend la déconstruction de concepts familiers mais cernés de malentendus. Et c’est peut-être cela, au fond, la visée politique du livre : rappeler que ce que l’on croit le plus commun est souvent le plus construit – et donc le plus contestable.
« L’affirmation nationale construit, à grand renfort d’images, de sentiments et de valeurs, une évidence qui est en fait toujours susceptible de se dérober. » C’est en ces termes que Sarah Mazouz établit la nation comme fiction collective. Une fiction puissante, certes, mais criblée de trous. L’auteure s’arme des sciences sociales pour refuser les intuitions trop hâtives. À ceux qui naturalisent la nation, elle oppose l’historicisation ; à ceux qui fétichisent les origines, elle rappelle leur pluralité, leur trouble, voire leur invention.
« Les nations sont des réalités mouvantes sur le plan administratif et géographique. Elles le sont également sur le plan des imaginaires – politiques ou culturels – et des symboles. » Pour le démontrer, l’ouvrage traverse le temps comme on fend les couches d’un palimpseste. Il montre que ce qui semble stable – les frontières, les récits, les langues – est en vérité traversé de recompositions, constitué de bricolages, soumis aux refontes. L’historien Benedict Anderson en atteste : la nation est une communauté imaginée. Et Sarah Mazouz, elle, en analyse méthodiquement l’imaginaire.
Avant le XVIIIe siècle, le mot nation désignait surtout des groupes en marge : populations païennes, communautés étrangères ou encore collectifs professionnels parfois vus de manière péjorative. Ce n’est qu’avec la Révolution française que la nation acquiert son sens politique moderne, devenant une entité souveraine fondée sur l’adhésion à un projet commun. Portée par la pensée de Sieyès, elle incarne désormais la collectivité des citoyens, rompant avec la société d’ordres et introduisant l’égalité comme principe. Toutefois, cette citoyenneté reste inégalitaire, réservée aux hommes jugés actifs, excluant femmes, pauvres et mineurs. Et si un patriotisme ouvert permet d’abord aux étrangers d’être intégrés, les inquiétudes liées à la guerre et à la contre-révolution réintroduisent des critères d’origine et d’appartenance sociale.
« Il est toujours possible d’unir les uns aux autres par les liens de l’amour une plus grande masse d’hommes, à la seule condition qu’il en reste d’autres en dehors pour recevoir les coups. » Cette citation de Freud n’est pas convoquée par hasard. Elle résume à elle seule la mécanique sacrificielle du nationalisme. Car si la nation peut donner un sentiment d’appartenance, elle le fait au prix d’un partage brutal : dedans/dehors, nous/eux, nationaux/étrangers. Et ce partage n’est pas qu’imaginaire, puisqu’il s’incarne dans des pratiques administratives, des politiques de naturalisation, des lois de nationalité. Souvent, le naturalisé reste un « à-peine-national », un corps présent mais suspendu, toujours assigné à devoir prouver – sa loyauté, son adhésion, son mérite. Ce que la République promet comme universalité, elle le distribue en vérité avec parcimonie.
Sarah Mazouz déploie ici une lecture genrée et postcoloniale. Si le nationalisme est un système culturel, il constitue aussi un dispositif de pouvoir, traversé par les hiérarchies de race, de genre, de classe. Les critères d’assimilation, les exigences morales imposées aux candidats à la nationalité, les soupçons qui pèsent sur les pratiques culturelles minoritaires, tout cela tend à former une architecture de l’exclusion. Et l’auteure rappelle d’ailleurs que l’Algérie coloniale fut le laboratoire de cette gestion racialisée des appartenances. Le paradoxe apparaît alors brutal : ce qui se veut universel s’applique en fait inégalement. Chemin faisant, le nationalisme parvient à faire passer une frontière, un quasi-schisme, pour une cohésion.
« Le nationalisme en général substitue la question de l’identité à celle de l’égalité. » On touche probablement ici au cœur politique du propos. À force de mettre en avant une supposée communauté d’origine ou de valeurs, le nationalisme détourne le regard des inégalités concrètes. Il offre des appartenances, mais escamote les dominations. Il propose des mythes, mais efface les conflits. Et quand la crise gronde, il désigne des ennemis – migrants, musulmans, juifs, femmes, LGBTQI+, etc. – pour conjurer la peur. C’est à ce moment-là que le nationalisme cesse d’être un sentiment et devient une arme. Une manière de canaliser le ressentiment vers l’extérieur plutôt que de questionner l’intérieur.
En affirmant que l’identité nationale suffit à résoudre les problèmes sociaux, le nationalisme passe sous silence les rapports de pouvoir au sein du groupe national, créant un espace propice au conservatisme. Les radicalisations nationalistes misent sur la nostalgie et la promesse de restaurer la grandeur du pays, par exemple, pour capter et exploiter le ressentiment et la colère. Elles désignent des ennemis intérieurs et extérieurs (souvent des groupes minorisés ou racialisés) comme responsables du déclin, unifiant ainsi une partie de la population contre une « autre » perçue comme une menace.
Arme civique ou instrument de domination, le droit du sol est lui aussi largement discuté dans Nation. Il « n’est pas en soi libéral ou démocratique ». Voilà un coup de griffe inattendu dans les certitudes progressistes. Car non, rappelle l’auteure, le droit du sol, institué en 1889, n’est pas né d’une générosité républicaine mais d’un souci d’efficacité militaire : il s’agissait de pouvoir enrôler dans l’armée les enfants d’étrangers nés en France. Ironie de l’histoire : ce qui est aujourd’hui défendu comme un rempart contre l’exclusion a été, dans son origine, un outil d’emprise et de domination. Le cas du Chili de Pinochet apparaît tout aussi intéressant : « Le fait que ce soit la naissance sur le sol qui conditionne la possibilité pour des parents de transmettre leur nationalité à leurs enfants a été utilisé comme l’un des moyens d’exclure de la nationalité chilienne les enfants d’opposant·es politiques exilé·es né·es à l’étranger. » Aucun dispositif n’est pur. L’histoire des politiques de nationalité, loin d’être une marche linéaire vers l’inclusion, s’apparente davantage à des zones de tensions, d’intérêts, de rapports de force.
« L’oubli et je dirais même l’erreur historique sont un facteur essentiel de la création d’une nation », postulait en son temps Ernest Renan. Il faut tirer toutes les conséquences de cette assertion. Car si l’oubli est nécessaire, alors la mémoire nationale demeure en tout temps une opération de sélection, et donc de falsification. Matériau malléable, l’histoire se met volontiers au service d’un récit national incubateur d’une conscience communautaire, voire d’une idéologie nationaliste. Sarah Mazouz le verbalise en évoquant la fabrique des mythes fondateurs : manuscrits inventés, textes exaltés, héros nationaux sculptés dans l’argile du fantasme.
« L’histoire offre donc des événements à partir desquels la geste nationale se crée. Toutefois, alors que la perspective de la science et de la méthode historiques cherche à les établir des faits, le discours nationaliste fait usage de l’histoire sans se soucier des sources et selon des modalités qui vont de la sélection d’événements qu’on estime marquants à la simplification de leur sens ou à leur occultation, voire à leur falsification, à des fins d’instrumentalisation ou parfois de manipulation. C’est pour cette raison d’ailleurs que l’enseignement de l’histoire est un enjeu pour le nationalisme… »
Nation. Sarah Mazouz ne prône ni l’abolition du mot, ni sa vénération. Elle le traite comme un outil, qu’il faut manier avec une grande précaution. La nation, écrit-elle, n’est ni bonne ni mauvaise en soi, mais elle peut basculer. Son efficacité réside dans sa plasticité. Elle peut être un lieu de conjugaison des légitimités, à condition de ne pas se figer dans l’exclusion. Car « il n’y a pas de solution simple et définitive ». Cette phrase appelle à la vigilance, à l’analyse, au refus des réponses toutes faites.
Dans la collection « Le mot est faible », Nation ne fait pas que questionner le vocable : il remet en cause les structures mentales et politiques qui nous font croire que ce concept tient lieu d’évidence. En cela, le livre de Sarah Mazouz constitue un exercice d’émancipation intellectuelle. Un rappel intraitable. Car sur certains sujets, penser, problématiser, contextualiser constitue toujours un acte de dissidence.
J.F.
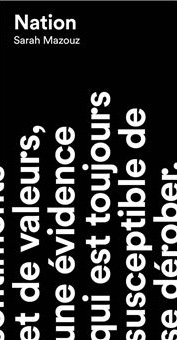
Nation, Sarah Mazouz – Anamosa, juin 2025, 112 pages

Laisser un commentaire