
Il a suscité autant de fascination que de malaise. Le parcours de Bret Easton Ellis se construit sur le fil d’un scalpel. D’un côté, la critique d’une Amérique consumée par l’argent et l’apparat ; de l’autre, une attirance quasi passionnelle pour la décadence. Dans son essai Bret Easton Ellis, le privilège de la subversion, le critique culturel Adrien Durand dresse le portrait d’un romancier talentueux et sulfureux, dont la plume a inspiré autant de dévotion que de scandales.
Bret Easton Ellis grandit dans la banlieue californienne cossue de Sherman Oaks. La bourgeoisie blanche y déploie ses fastes, mais aussi ses vices, à ciel ouvert. On y trouve également une jeunesse en roue libre, marquée par la démission parentale, la psychose ambiante – la prolifération des tueurs en série – et la drogue qui circule quasi librement dans les couloirs d’un lycée finalement plus proche du club privé que d’un sanctuaire éducatif. C’est dans ce terreau quelque peu vicié que se développe chez le jeune Ellis une passion précoce pour les films d’horreur, ceux qui déchirent le voile du bien-pensant pour laisser entrevoir l’inavouable. Le futur romancier semble déjà partagé entre l’envie de s’écarter du monde et l’irrésistible tentation de s’y fondre en voyeur-obsessionnel.
C’est en 1985 qu’il fait une entrée tonitruante en littérature avec Moins que zéro, un roman aux accents autobiographiques qui sonde l’âme désolée d’une jeunesse dorée, gangrénée par l’ennui, le cynisme et la drogue. Des protagonistes aisés, aux familles éclatées, y transgressent allègrement les conventions morales et flirtent avec les excès. Une première salve qui dessine déjà les contours du style Ellis : cru, féroce, mais aussi teinté d’une lucidité glaciale sur les rapports humains, la superficialité et l’incommunicabilité.
Son deuxième roman, Les Lois de l’attraction, parachève l’invention d’un véritable sous-genre : le roman trash de campus. Au cœur d’une université huppée du New Hampshire, des étudiants se droguent, couchent avec leurs professeurs, naviguent sans boussole dans un océan de fêtes et de superficiel. Bret Easton Ellis y portraiture une Amérique privilégiée ne vivant que pour jouir du présent et verrouiller son avenir dans les coulisses. Le ton scandaleux, la narration à la première personne et l’ironie implacable, proche de la satire, ont un effet coup de poing, affirmant l’écrivain comme l’un des représentants les plus brillants (et les plus décriés) de sa génération.
Adrien Durand donne parfaitement le ton de cette nouvelle littérature irrévérencieuse qui prend pour objet l’élite et ses ouailles, retranchées derrière les murs d’établissements plus festifs que scolaires. Dans le même temps, Bret Easton Ellis va former un duo controversé avec Jay McInerney. À deux, ils deviennent des “rock-stars de la littérature” : excès en tout genre, frasques médiatiques et fréquentations ultra-select, de Tom Cruise, nouveau voisin d’Ellis, à Jean-Michel Basquiat, avec qui l’écrivain partagera quelques lignes de coke dans des toilettes pour hommes. Ils déconstruisent, en actes, l’image de l’auteur introverti, travailleur et solitaire. Le Literary Brat Pack, qui réunit aussi Tama Janowitz ou Jill Eisenstadt, repose sur des oiseaux de nuit qui aiment se donner en spectacle.
L’Amérique de Reagan bat alors son plein, la finance triomphe. C’est dans cette fièvre capitalistique et libérale que naît Patrick Bateman, yuppie psychopathe, héros malade et mémorable d’American Psycho. Avant même sa parution, le texte fuite et scandalise par sa violence sanguinaire et son fétichisme maniaque pour le luxe. L’auteur doit changer d’éditeur, subit les foudres d’une presse résolue à le diaboliser. D’autres y voient un coup de génie – ou un coup marketing. Espiègle, l’auteur en rajoute, arguant qu’il ne fait que s’autobiographier à travers ce personnage de golden boy sociopathe.
Bret Easton Ellis, le privilège de la subversion porte décidément bien son nom. Et ne s’arrête pas en si bon chemin. S’ensuivent des années de hauts et de bas. Glamorama moque l’industrie de la mode, mais reçoit un accueil bien plus tiède. L’autocitation permanente commence par ailleurs à lasser. Dans Lunar Park, Ellis pousse la mise en abyme jusqu’à son paroxysme : sobriété retrouvée, autocritique subtile, il dépeint sa propre traversée du désert. L’évolution de l’écrivain fascine autant qu’elle interroge : devient-il sage ou se moque-t-il encore du monde, comme beaucoup le croient ?
Adrien Durand se recentre ensuite sur l’influence que Bret Easton Ellis a exercée sur Michel Houellebecq et Frédéric Beigbeder, mais surtout sur les auteurs du mouvement “Alt Lit”, biberonnés au micro-blogging, au culte de la célébrité et aux réseaux sociaux. Sur Twitter, le romancier provoque de nouveaux remous, notamment par des tirades parfois irrévérencieuses sur les femmes, voire ouvertement misogynes. Il révèle aussi son homosexualité, tardivement assumée.
Dans la lecture qu’en fait Adrien Durand, Bret Easton Ellis semble endosser tour à tour le rôle de dénonciateur et d’adepte enragé d’une société gangrénée, trop opulente pour être authentique. C’est celle d’Ethan Couch, l’“affluenza teen” à la dérive, ou de l’influenceur surexcité Jake Paul, toutes ces figures surgies du réel et qui semblent autant de Patrick Bateman en puissance. À la frontière de la réalité et de la fiction, Ellis a systématiquement renversé les codes, il s’est érigé en chantre de la provocation comme s’il ne pouvait y avoir de salut que dans la transgression.
Le livre Bret Easton Ellis, le privilège de la subversion radiographie ainsi les excès, les outrances et la prodigieuse modernité de ce romancier, devenu, selon les époques, roi de la scène littéraire ou paria conspué. Il demeure l’enfant terrible d’une contre-culture qui s’amuse à mêler luxe, gore et ironie mordante. Un pied dans l’enfer contemporain, l’autre dans l’ambition de tout déchiffrer, tout énoncer, tout exposer.
J.F.
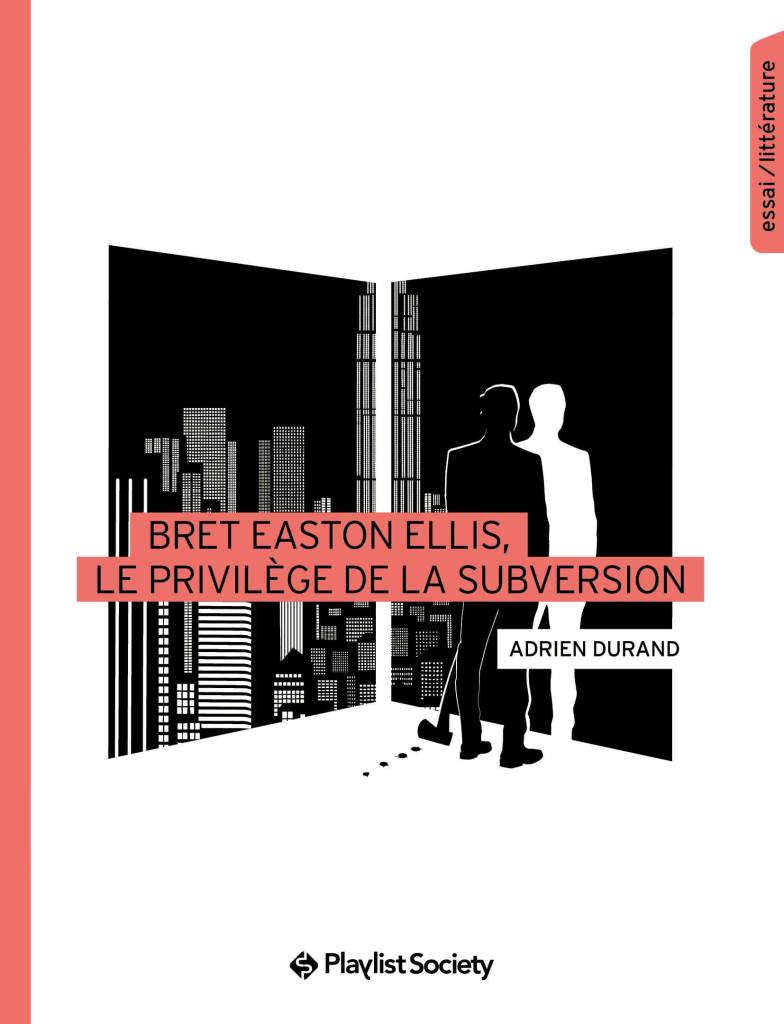
Bret Easton Ellis, le privilège de la subversion, Adrien Durand –
Playlist Society, janvier 2025, 160 pages

Laisser un commentaire