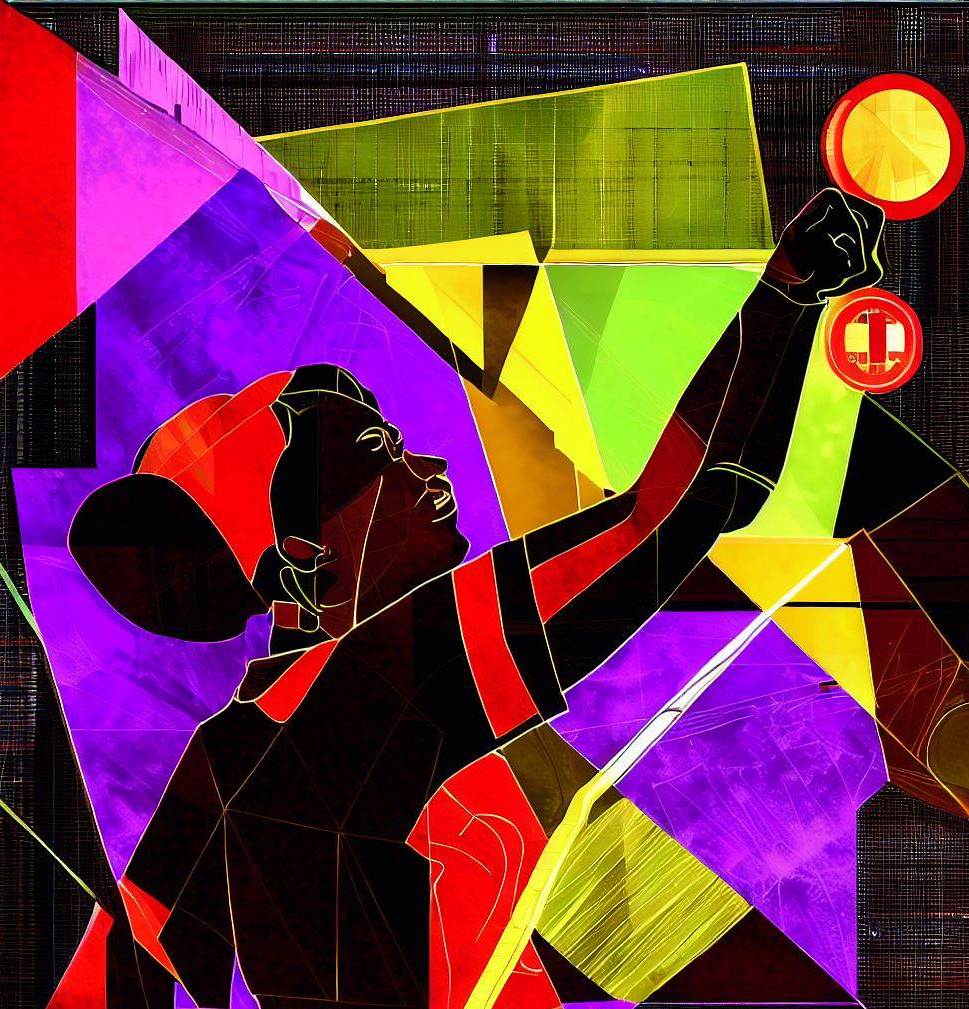
La sociologue Dahlia Namian publie aux éditions Lux un essai judicieusement intitulé La Société de provocation. Elle y met en lumière les inégalités socioéconomiques et verbalise la manière, souvent sournoise, dont les plus fortunés s’affranchissent à leur seul profit de certaines règles de la vie collective, tout en aggravant les problèmes environnementaux.
Énoncer la réalité des inégalités socioéconomiques ne nécessite pas toujours de longues démonstrations mathématiques. Ces iniquités de condition et de statut peuvent se matérialiser à l’aune d’éléments anodins, ou en tout cas universels, tels que l’océan ou la nourriture.
Dans son essai La Société de provocation, Dahlia Namian explique que les inégalités mondiales se reflètent notamment dans l’accès à une alimentation saine. Contrairement aux plus fortunés, les revenus modestes se trouvent contraints de privilégier la malbouffe, moins onéreuse et aisément disponible. Les conséquences sanitaires de cette inégalité sont souvent ignorées ou minimisées, voire attribuées à de prétendus mauvais choix alimentaires. Pendant que certains festoient à prix d’or et se gorgent d’aliments raffinés, d’autres, fascinés, sont absorbés par des émissions télévisées culinaires en contradiction avec leurs usages… ou souffrent de la faim. Ainsi, à l’échelle mondiale, l’ONU estime que 50 millions de personnes connaissent des situations de famine et que 800 millions se trouvent dans l’impossibilité de satisfaire à leurs besoins alimentaires. Rien qu’au Canada, ils seraient 7 millions à vivre dans un état de précarité nutritionnelle – les peuples autochtones étant particulièrement touchés en raison de la dépossession de leurs terres et ressources.
Parallèlement, les superyachts sont devenus le symbole de la richesse des élites ; leur taille et leur nombre augmentent au même rythme que les inégalités mondiales. Ces navires extravagants, dont la valeur peut atteindre plusieurs centaines de millions de dollars, sont équipés de luxueuses installations comme des héliports, des cinémas et des salons d’observation sous-marine. Tout le monde a encore en mémoire l’attitude arrogante de Jeff Bezos, qui a demandé à la ville de Rotterdam de démanteler un pont historique pour laisser passer son volumineux bâtiment maritime. Ces navires hors de prix constituent aujourd’hui autant de symboles de puissance pour l’élite du pouvoir, contribuant par ricochet à renforcer le statut des milliardaires. Mais pendant que les mers accueillent ces véhicules marins à gros impact environnemental, objets emblématiques de consommation ostentatoire, elles voient des migrants désespérés se noyer dans leurs eaux. Dahlia Namian le problématise très bien : la coexistence des superyachts et des migrants victimes de la Méditerranée (ou parqués dans des camps de réfugiés) met en lumière une société de provocation dont les ramifications semblent innombrables et foisonnantes.
La faim des privilèges
Nos sociétés actuelles voient les plus riches et les plus influents exploiter leur statut, développer des technologies soi-disant bénéfiques pour tous, pendant que les inégalités et les destructions environnementales perdurent. Les services publics se trouvent affaiblis par l’austérité budgétaire et l’optimisation fiscale. Pourtant, on continue d’admirer les riches, de les placer sur un piédestal, de nourrir un impensé collectif motivé par une méritocratie relevant plus de la foi que des faits. La société de provocation, nous dit Dahlia Namian, c’est celle d’une élite capitaliste cherchant à s’échapper de l’apocalypse dans des bunkers martiens, ou de fuir l’impôt par le seasteading, phénomène basé sur la création de cités-nations indépendantes sise en haute mer. C’est celle des milliardaires qui camouflent les inégalités de richesse en utilisant la philanthropie, comme Mark Zuckerberg et Bill Gates. Ces philantrocapitalistes emploient une rhétorique compassionnelle et égalitaire pour apaiser le mécontentement social sans pour autant remettre en cause leur pouvoir et richesse. C’est aussi celle des voyages modernes, passés des symboles « beatnik » de liberté et d’évasion individuelles à la surconsommation et au règne de l’apparence (promus par certains youtubeurs influents). Cette société où le peu de temps libre est colonisé par le divertissement et les technologies de surveillance laisse en héritage des problèmes majeurs tels que les bouleversements climatiques, l’emploi précaire et l’endettement.
Très critique, Dahlia Namian évoque les « révolutions vertes » aux effets néfastes sur l’environnement et les agriculteurs locaux, certes bénéfiques aux grandes entreprises, mais s’octroyant le monopole du commerce des cultures génétiquement modifiées et écrasant les petits paysans, tout en augmentant la consommation d’énergie et les émissions polluantes. Elle note que les philanthropies capitalistes (Fondation Bill et Melinda Gates, Fondation Rockefeller) favorisent un modèle économique qui exacerbe les inégalités et les problèmes écologiques, plutôt que de chercher à les résoudre de manière durable. L’auteure opère un lien entre la banalité du mal telle que décrite par la philosophe Hannah Arendt et les systèmes de prédation mis en place par les plus riches.
Ce « mal normalisé » persisterait dans les démocraties libérales et se manifesterait même dans des régimes de droit parfaitement régulés. Car en réduisant la valeur d’une vie à des calculs de pertes et profits, le néolibéralisme nous dépouillerait en fait de notre humanité. Mais ce n’est pas tout, puisque la langue bureaucratique utilisée par les nazis et mise en lumière par le philologue Victor Klemperer, qui soulignait l’importance de la mécanisation et de la déshumanisation du langage dans l’adhésion à la barbarie génocidaire, trouverait son pendant dans une novlangue managériale soulevant des questions sur l’impact du langage sur notre capacité à agir contre ce qui nous détruit collectivement. L’écrivaine Sandra Lucbert a qualifié cette langue managériale de LCN (Lingua Capitalismi Neoliberalis). Comme le rappelle à dessein Dahlia Namian, contrairement aux régimes totalitaires, la banalisation du mal dans les sociétés néolibérales peut se passer d’un chef et se loger dans l’esprit d’une rationalité financière sans visage.
Henry Ford et les Expositions universelles comme signes avant-coureurs
Le 1er mai 1851, l’Exposition universelle de Londres célèbre la puissance de l’Empire britannique, passant sous silence, pour des raisons évidentes, les inégalités sous-jacentes. L’exposition de Montréal de 1967 symbolisera quant à elle la réconciliation des Québécois avec leur identité, mais au prix, cependant, de l’expropriation des familles pauvres. En 2022, c’est Dubaï qui accueille une Exposition universelle, parfait reflet de la démesure et du capitalisme effréné.
En son temps, Henry Ford a cherché à contourner le monopole du caoutchouc. Il a façonné, conformément à ses visions utopiques, une ville extractiviste baptisée Fordlandia, en Amazonie. De cette entreprise inconsidérée demeurent aujourd’hui des vestiges et des conséquences désastreuses sur la nature. Le fordisme et le consumérisme qu’il impliquait ont transformé la société, toujours plus symbolisée par l’automobile et une industrie délocalisée vers les pays du Sud. Avec ses véhicules, Henry Ford n’a pas seulement révolutionné un management dont les injonctions s’imposaient jusque dans les foyers des ouvriers, mais il a aussi contribué à horizontaliser des métropoles devenues gigantesques, contre lesquelles il s’insurgeait pourtant.
En lisant Dahlia Namian, on comprend que tout ceci n’a été que le signe avant-coureur d’un phénomène bien plus vaste. La Silicon Valley incarne aujourd’hui la nouvelle économie. La révolution numérique et les véhicules électriques contiennent leur lot de promesses, souvent fallacieuses. Ainsi, Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, a amassé une fortune colossale grâce à l’exploitation de travailleurs précarisés et soumis à des cadences infernales. Malgré des critiques documentées et répétées, Amazon continue de prospérer, infiltrant notre quotidien avec des gadgets numériques, et étendant son emprise, toujours plus tentaculaire, sur le commerce mondial. Elon Musk, quant à lui, impose une discipline stricte à ses salariés et lutte contre les tentatives de syndicalisation. Est-ce là notre modèle de société 2.0 ?
Dans certains cercles, les idées libertariennes prospèrent : elles partagent un mépris envers l’État, les impôts et cultivent volontiers le déni des changements climatiques. Cela, aussi, détermine cette société de la provocation dénoncée avec talent et conviction par l’auteure. Une idée glaçante appuie en tout cas sa réflexion : il semble désormais plus facile d’imaginer la fin du monde que celle du capitalisme.
J.F.
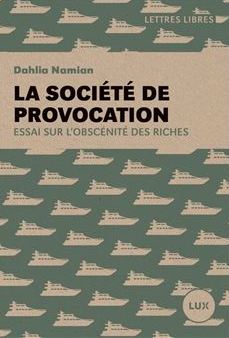
La Société de provocation, Dahlia Namian – Lux, août 2023, 240 pages

Laisser un commentaire