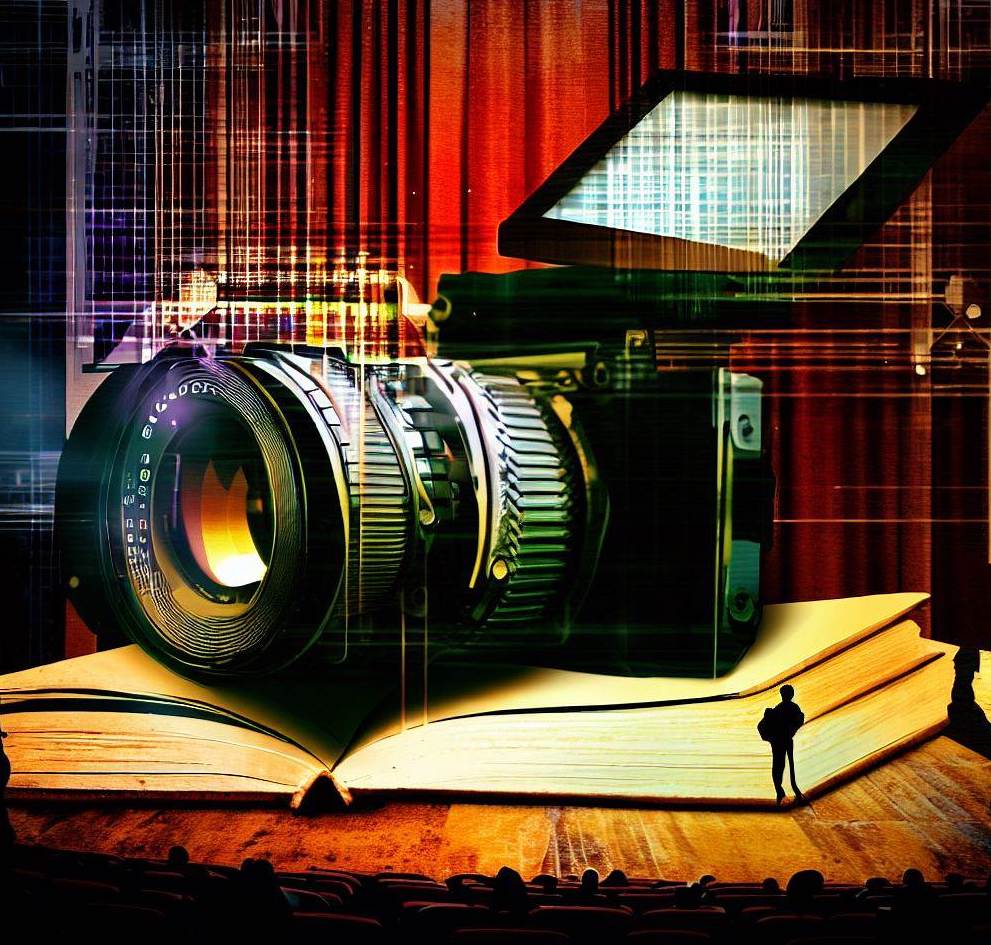
« Un art est né sous nos yeux […] Il s’est assimilé rapidement des éléments pris à tout le savoir humain. Ce qui fait la grandeur du cinéma, c’est qu’il est une somme, une synthèse aussi de beaucoup d’autres arts. » – Georges Sadoul
Lorsqu’il publie la préface de Cromwell en 1827, Hugo révolutionne la dramaturgie française, engoncée jusqu’alors dans le carcan du classicisme, soumis notamment aux lois de la bienséance, de la vraisemblance, et limitant son écriture aux sacro-saintes règles des unités : une intrigue sur vingt-quatre heures, en un seul lieu, et sans récits secondaires. Le drame romantique sera libre, soucieux du vrai, reprenant de Shakespeare notamment ces reflets mouvants qui mêlent en un seul élan le comique et le tragique. Ce qu’on oublie souvent, c’est que cette célèbre préface a occulté la pièce en elle-même, Cromwell, qui se veut déjà une mise en application des préceptes défendus par le fougueux romantique de 25 ans. Et pour cause : d’une longueur démesurée (près de 7000 vers, soit quatre fois plus qu’une tragédie classique), mobilisant des centaines de figurants, des décors d’une variété ingérable, et des scènes sur plusieurs tableaux simultanés (l’intérieur d’une cathédrale, son parvis, une foule grondante…), la pièce est tout bonnement injouable. En réalité, avec près de soixante ans d’avance, Hugo a inventé le cinéma, cet art qui naitra dix ans après sa mort. Le mouvement romantique entier convergera vers le septième art : par cette vigueur donnée aux récits dans lesquels prime le sentiment, faisant encore loi dans les grandes productions hollywoodiennes actuelles, et par cette volonté de fusionner les arts dans une seule manifestation, l’opéra, qui trouvera un digne et populaire successeur dans la forme cinématographique.
À l’échelle de l’histoire de l’art, le cinéma est donc l’art d’après, au septième rang d’une classification qui ne convainc pas tout le monde, mais a le mérite de hiérarchiser une certaine chronologie. C’est surtout l’un des premiers à être aussi dépendant des avancées technologiques, ce qui explique une genèse un peu tâtonnante avant qu’on ne puisse réellement le qualifier de discipline artistique. Le cinéma est davantage une attraction foraine à ses origines, un de ces jeux d’illusions pour lesquels on glisse une pièce avant de contempler un manège d’images mouvantes. L’arrivée des frères Lumière l’oriente d’abord du côté du documentaire : leurs plans fixes des sorties d’usine ou d’un quai de gare ont tout de la carte postale mouvante, et ils enverront ainsi leurs opérateurs filmer les quatre coins du monde dans les dernières années du XIXème siècle. Très vite, pourtant, l’idée du divertissement par le récit s’insère dans la forme filmique : c’est un gag (l’arroseur arrosé), un effet spécial (le cinéma de Méliès) qu’on pourra projeter à l’envi. De ce fait, l’invention du cinéma est aux arts de la scène ce que fut celle de l’imprimerie de Gutenberg à la diffusion des écrits : tout est désormais copiable, exportable, diffusable à grande échelle.
Le cinéma n’existe donc pas de manière autonome : il est littéraire par son écriture, et très vite orné d’un accompagnement musical (un piano, voire un orchestre pour les projections les plus prestigieuses) qui, à partir de 1927, va intégrer directement la pellicule. Les premiers films sont ainsi des adaptations littéraires qui se limitent, par le plan fixe, à une sorte de théâtre filmé, auxquelles vont progressivement s’adjoindre dialogues, musique et enfin la couleur : désormais, l’autre illustre ancêtre qu’est la peinture peut faire son entrée. Les grandes œuvres cinématographiques sont, ainsi que l’affirme Sadoul, une véritable somme : épopées grandioses (les superproductions américaines, des péplums aux films de guerre, de Ben Hur à David Lean, en passant par la geste japonaise de Kurosawa), opéras cosmiques (Star Wars), alliant la largeur du cinémascope à l’infinité des possibles dématérialisés par l’image de synthèse.
Cette fusion cristallise tous les arts et marque une nouvelle étape dans l’expérience de celui qu’on nomme de façon assez réductrice spectateur, alors qu’il est contemplateur de l’image, lecteur d’un récit et auditeur d’une musique. Regarder La Prisonnière du Désert, c’est entrer dans un paysage et voyager dans le temps par la grâce du technicolor ; visiter l’hôtel de Psychose nous intègre dans une toile d’Hopper. Écouter Apocalypse Now ou Phantom of the Paradise, c’est mobiliser toute sa sensibilité, et relire des morceaux de musique à la lumière d’un angle qui marquera éternellement la rétine, tout comme le fait Carax avec Bowie dans Mauvais Sang. Le cinéma serait donc l’aboutissement de tous les arts qui le précèdent, faisant du divertissement la grand-messe populaire du XXème siècle, un succès qui ne se dément pas aujourd’hui malgré la concurrence féroce d’autres industries du divertissement, de la série télévisée aux jeux vidéo. Dévorant même ses prédécesseurs, il devient capable d’évoquer comme personne les arts qu’il a phagocytés, à l’image du monde du théâtre devenu le décor du Septième Sceau de Bergman ou de l’Eve de Mankiewicz : on y verra le déploiement d’un univers fictionnel ou les coulisses retorses du monde du spectacle, comme si seul le cinéma parvenait à atteindre ce degré de vérité du regard.
Mais si la grandeur du cinéma s’explique par le fait qu’il soit une somme de ses prédécesseurs, qu’en est-il de son identité propre ? Se résumerait-il à un habile art de la compilation, soutenu par des artifices techniques qui favorisent le confort – la paresse, diront certains puristes – du spectateur passif devant une débauche de mouvements, de couleurs et de sons ? Questionner la forme cinématographique à l’aune de ses influences, c’est surtout percevoir la complexité d’un art qui se construit par couches successives, mais n’a jamais abandonné l’ambition d’affirmer une esthétique autonome. Bien avant l’avènement du parlant ou de la couleur, le cinéma a su tirer parti de nouveaux possibles. L’appréhension de l’espace, par exemple, est la grande force en vigueur dans l’expressionnisme allemand de fondateurs comme Murnau ou Lang dont l’influence irriguera tout un pan du cinéma, jusqu’à des chefs-d’œuvre graphiques comme La Nuit du Chasseur qui revisite l’imaginaire enfantin par un travail d’exception sur la lumière et l’onirisme des images. Cette exploration de l’architecture, (aussi exploitée avec une force unique dans l’escalier et la douche de Psychose) autre grand art antique, en dit long sur l’appétence du cinéma, qui se veut un regard panoramique sur la production artistique humaine. Il en sera de même avec la sculpture, travail sur la matière qui se retrouvera dans la manière dont les chefs opérateurs vont façonner la lumière et densifier leurs atmosphères, que ce soit dans Le Septième Sceau et ses processions cauchemardesques ou le grain de peau d’un crâne luisant apparaissant dans Apocalypse Now.
Aujourd’hui, alors que le septième art s’est vu dépasser par de nouveaux arrivants (la bande dessinée en neuvième position, le jeu vidéo en dixième) les frontières sont plus poreuses encore entre les genres, parce qu’il n’a jamais abandonné ce réflexe de faire siens les moyens d’expression qui cohabitent, voire le concurrencent : les échanges entre des univers comme Star Wars ou bien entendu la saga Matrix (comme tout le cinéma des Wachowski) et le jeu vidéo sont plus que féconds, quand ils dépassent la simple frénésie visuelle destinée à vendre des produits dérivés. De la même manière, le manga peut être aussi vif à feuilleter qu’à visionner, surtout lorsque le créateur lui-même passe au grand écran, comme Otomo avec Akira. Aujourd’hui, il est possible d’adapter un comic en dépassant l’exploitation d’un fonds infini d’intrigues de super-héros au succès garanti. Le récent et bien nommé Spider-Man New Generation en témoigne, insufflant dans la machine moribonde du blockbuster la dynamique des strips, des bulles et des cases pour un renouvellement salutaire du plaisir esthétique.
Le recours aux arts préexistants n’est en réalité qu’une impulsion de départ, ou une facilité qui ne fait pas longtemps illusion dans les productions les plus formatées. La grandiloquence d’une bande originale tout en cuivres symphoniques peut certes aller puiser dans l’opéra, mais son souffle sera limité si on se contente de la plaquer paresseusement, sans réfléchir à son interaction avec l’image. Car c’est bien là le génie de cet art parasite que d’avoir su faire de ses modèles des outils au service d’une nouvelle forme. De ce point de vue, ce sont sans doute ses liens avec la musique qui sont les plus éclairants. Dès les origines, les premières expériences sur le montage assimilent l’écriture à la rythmique d’une partition. Que ce soit chez les formalistes russes (Eisenstein et son Cuirassé Potemkine, la fantastique expérience du Ciné-Œil de Dziga Vertov dans L’Homme à la caméra) ou dans l’art chorégraphique du gag chez un Chaplin et un Keaton, le montage est une dynamique sans équivalent qui justifie à lui seul l’étymologie même du terme cinéma : s’il est art du mouvement, c’est moins dans sa capacité à montrer des images mobiles qu’à ménager une mobilité entre ses différents plans, au sein de séquences d’une efficience dramaturgique unique. Revoir ainsi de grands films sur la musique atteste de cette richesse de lecture. Dans Fantasia, Walt Disney donne corps au fantasme ultime de fusion entre la mélodie et la ligne graphique, tandis que Milos Forman parvient, avec Amadeus, à faire de la musique un personnage à part entière, conditionnant le montage et la construction d’un récit sur les origines de la création.
Sadoul avait en réalité anticipé cette question, lui qui ne se borne pas à évoquer la somme, mais emploie aussi le terme de synthèse. Dans « Correspondances », Baudelaire théorisait sur les synesthésies, cette possibilité de faire se répondre les sens :
Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
Paradoxe fécond, le recours à la poésie semble en effet salutaire pour comprendre ce qui fait du cinéma un art à part entière. La fusion des expressions tisse un réseau d’échos qui, loin de s’accumuler, ouvre la voie à une mélodie nouvelle, sur le principe hautement défendu par le poète et ses successeurs, Rimbaud notamment, de l’alchimie. La grandeur du cinéma se mesure non à l’empilement de ses références, mais à sa capacité à déployer une fascination intense au sein d’un cadre qui s’approfondit d’un champ d’investigations infinies : si Apocalypse Now excite, c’est par sa capacité à doubler une séquence d’attaque d’une dimension opératique d’une ironie féroce sur la force de destruction américaine. Si The Tree Of Life fascine, c’est grâce à cette convocation des différentes désinences du lyrisme, musical, émotionnel, discursif, paysagiste ou portraitiste. La marque des géants – Fellini, Welles, Bergman, Tarkovski, Kurosawa, Kubrick, Leone – se trouve ici : dans le bouleversement à voir la picturalité suspendre le temps, la mélodie des images dessiner un indicible discours, le plaisir du montage décupler l’attente, la profondeur de l’espace s’épaissir d’une intelligence redoutable.
Appréhender le cinéma permet ainsi de passer des émotions du spectateur aux contemplations de l’esthète, du divertissement populaire au chef-d’œuvre patrimonial ; l’un n’efface pas pour autant l’autre, mais renforce la spécificité de cette tardive expression à l’échelle de l’Histoire : aux confluents des autres, vers un nouvel horizon. Un art total.
Éric Schwald

Laisser un commentaire